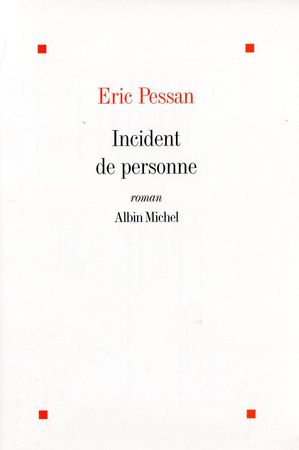Dans Des Vie d’oiseaux, Véronique Ovaldé repousse les limites de l’imagination à travers le destin de quatre personnages en prise directe avec une réalité en crise. L’écrivain évoque la force de l’amour qui pousse à éprouver sa propre liberté. Entretien autour de ce roman ardent et subtil.
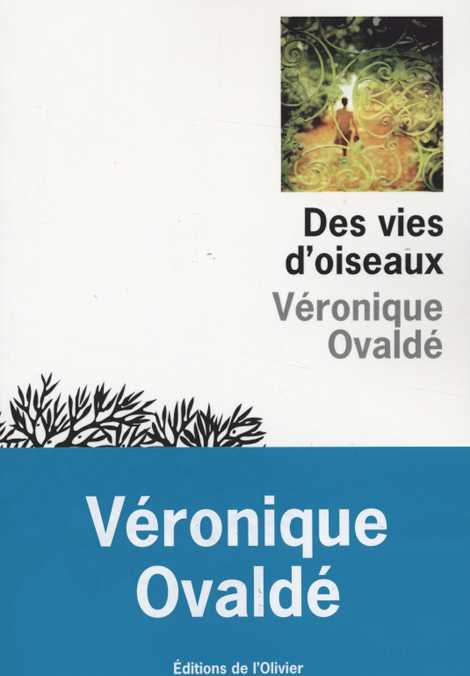 Être à l’affût de l’ordinaire nous permet d’en sortir, pourrait-on se dire en suivant les personnages du dernier roman de Véronique Ovaldé. Dans un pays imaginaire d’Amérique latine, Vida Izzara part à la recherche de Paloma qui a déserté l’étouffant et confortable nid familial, en compagnie du jeune jardinier Adolpho. Cherchant à s’expliquer le comportement de sa fille, la mère croit déceler chez Paloma une volonté d’échapper au quotidien banal et réducteur offert par la bonne société de Villanueva. L’enquête qu’elle entreprend au côté du rassurant lieutenant Taïbo, éclaire le comportement de sa fille, et pousse Vida à poursuivre sur une voie plus incertaine dont elle n’osait jusqu’ici soupçonner l’existence. Véronique Ovaldé tient ces quatre personnages dans une main, avec l’autre, elle jette les dés de leur destin sur le tapis des inconsolables amoureux de la vie.
Être à l’affût de l’ordinaire nous permet d’en sortir, pourrait-on se dire en suivant les personnages du dernier roman de Véronique Ovaldé. Dans un pays imaginaire d’Amérique latine, Vida Izzara part à la recherche de Paloma qui a déserté l’étouffant et confortable nid familial, en compagnie du jeune jardinier Adolpho. Cherchant à s’expliquer le comportement de sa fille, la mère croit déceler chez Paloma une volonté d’échapper au quotidien banal et réducteur offert par la bonne société de Villanueva. L’enquête qu’elle entreprend au côté du rassurant lieutenant Taïbo, éclaire le comportement de sa fille, et pousse Vida à poursuivre sur une voie plus incertaine dont elle n’osait jusqu’ici soupçonner l’existence. Véronique Ovaldé tient ces quatre personnages dans une main, avec l’autre, elle jette les dés de leur destin sur le tapis des inconsolables amoureux de la vie.
Par quelle porte s’est ouvert le récit ?
J’ai commencé par écrire l’histoire de la chasse au bison. C’est un passage qui se passe entre Adolpho et son père. En plein hiver, le père réveille son fils le jour de ses quatorze ans. Sous le prétexte d’en faire un homme, il va l’entraîner dans une expérience terrifiante.
Dans le livre, Paloma et sa mère Vida sont toutes deux portées par une force émancipatrice qui les pousse sur le chemin de leur liberté, mais, à mon sens, cette quête ne se résume pas aux personnages féminins.
Je crois bien que les liens profonds et douloureux qui se révèlent entre le père et son fils dans la scène du bison ont imprégné le récit et se sont déployés à travers les quatre principaux personnages. Chacun d’entre eux est entravé par lui-même et doit s’affranchir de ses propres chaînes.
Vous jouez sur la dualité des atmosphères entre légèreté et intensité onirique, entre Villanueva, le quartier ennuyeux des gens biens, et l’Iligoy où ils vivent comme des chiens…
Les disparités géographiques correspondent souvent à des disparités sociales. Dans le livre, des scènes violentes entrecroisent des scènes d’amour pleines de douceur. Mes textes sont en prise avec cela, c’est-à-dire quand il y a matière au mélange entre le tragique et le burlesque.
J’aime me plonger dans un contexte pour observer les gens dans leur tiraillement. Parfois le fil se casse. Ce moment m’intéresse.
On a l’impression que vous puisez dans votre trésor intime de souvenirs et d’images. Est-ce une façon d’être qui vous habite en permanence ou correspond-elle à des moments précis dans votre travail ?
Je crois qu’en tant qu’auteur on vit en regardant en même temps ce que l’on est en train de vivre.
On traficote avec le langage pour mettre des mots sur ce qui se passe. Nous sommes des êtres de langage. Quand j’étais enfant, je me regardais et j’entendais la petite voix en moi. Aujourd’hui j’habite toujours mon langage, c’est quasiment un état permanent.
Vous flirtez avec le roman noir en empruntant quelques ingrédients au genre…
On le décèle surtout dans le démarrage. Je crois que ce rapport au noir tient davantage à mon propre système de déchiffrement qu’aux modalités spécifiques du genre. Chacun de mes livres me conduit à cerner les personnages, à suivre les traces pour aller vers l’énergie des êtres.
Finalement pour moi un livre est une forme d’enquête. J’opère en faisant des liens. Je me crée mon propre petit suspens qui me pousse à chercher ce qui se cache derrière les apparences.
A quoi tient ce découpage original du roman en trois parties ?
J’ai écrit une première version du livre dans laquelle chacun des personnages racontait l’histoire à partir de son point de vue. Ce type de structure demande beaucoup de subtilité. Pour ne pas que cela soit trop artificiel, je suis entrée dans leur peau.
J’ai pris leur langue. Je me suis appliquée à ce que chacun ait ses propres tics de langage. Quand j’ai relu, je me suis dit que mes personnages s’étaient trop isolés. En procédant de la sorte, j’avais perdu ma voix. Finalement j’ai tout repris pour retrouver la part de moi-même qui s’était égarée.
Du coup, j’ai redistribué la place des personnages dans le récit. J’ai supprimé beaucoup de choses. J’opérais les coupes avec une certaine jubilation. J’en connais beaucoup plus sur mes personnages que ce que je restitue. Cette connaissance créé leur richesse et leur mystère, et donne un espace aux lecteurs, qui devinent tout cela.
Des vie d’oiseaux c’est aussi une histoire de transmission entre une mère et sa fille et réciproquement…
Je voulais aborder la façon dont on se perd de vue. Comment passe-t-on de l’amour exclusif d’une mère pour son enfant, une forme d’amour fou, à la nécessité que cela disparaisse.
Comment vivre cela ? Dans le livre Vida et Paloma n’arrivent plus à se parler. Elles sont prises dans un mille-f euilles de malentendus jusqu’à ce que l’une porte l’affranchissement de l’autre. Mais qui est le vrai déclencheur ?
La relation d’amour passe par la liberté…
Sans se l’avouer, Vida donne à sa fille la possibilité de sa liberté. On ne peut attendre de l’amour qu’il offre les garanties de son toaster. En partant à la recherche de sa fille, Madame Izarra qui remplissait jusqu’ici ses fonctions d’esclave conjugale, devient Vida. Elle quitte sa prison dorée pour répondre à ses aspirations profondes. Elle comprend où elle est et d’où elle vient ce qui lui permet de construire une vraie relation d’amour.
recueillis par Jean-Marie Dinh (César)
Voir aussi : Rubrique Livre, Littérature française, rubrique Rencontre, Eric Pessan,
Des Vie D’oiseaux, Editions de l’Olivier 2011