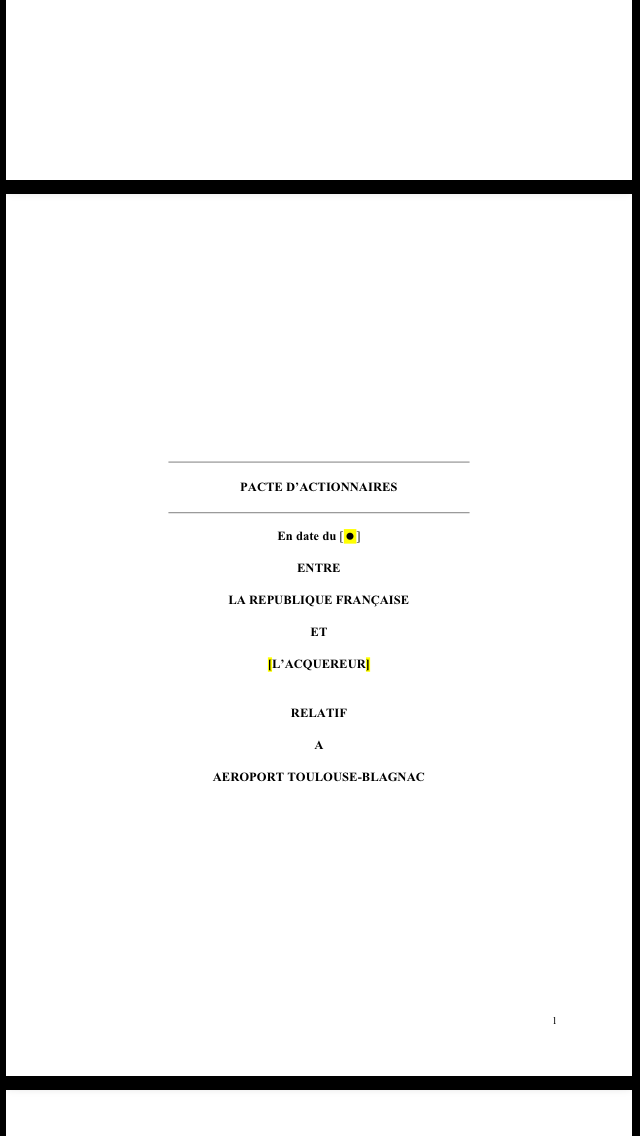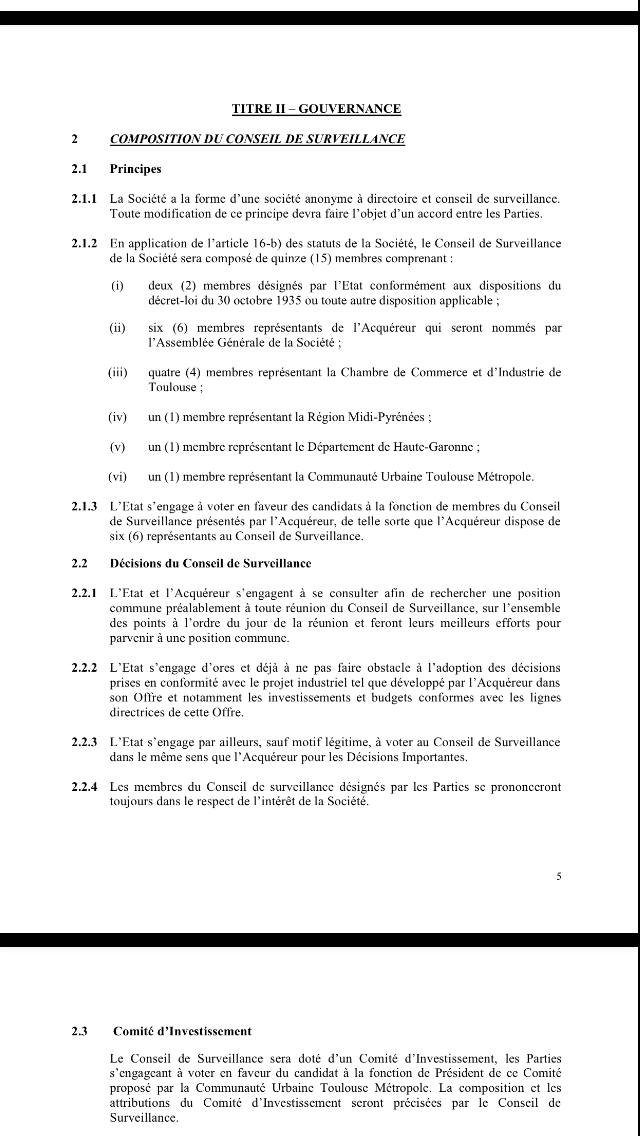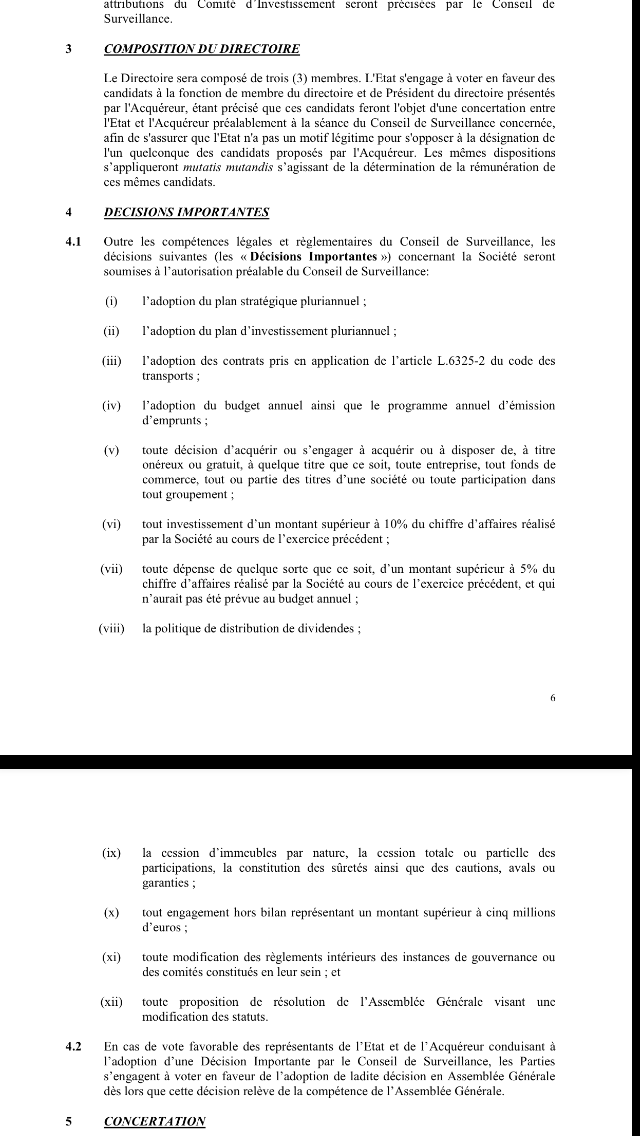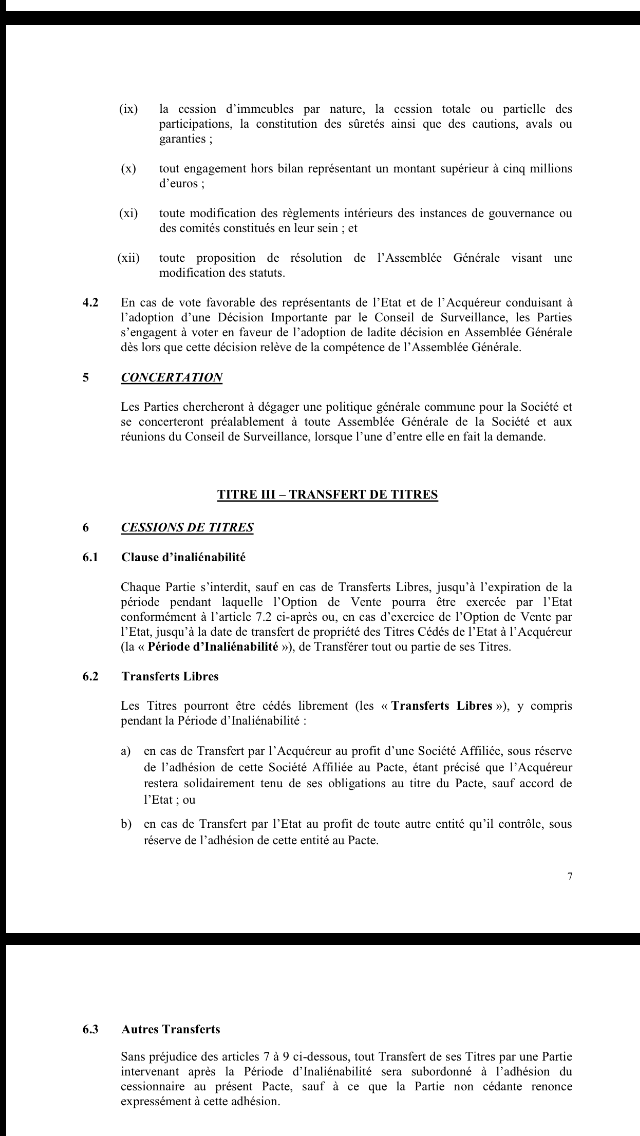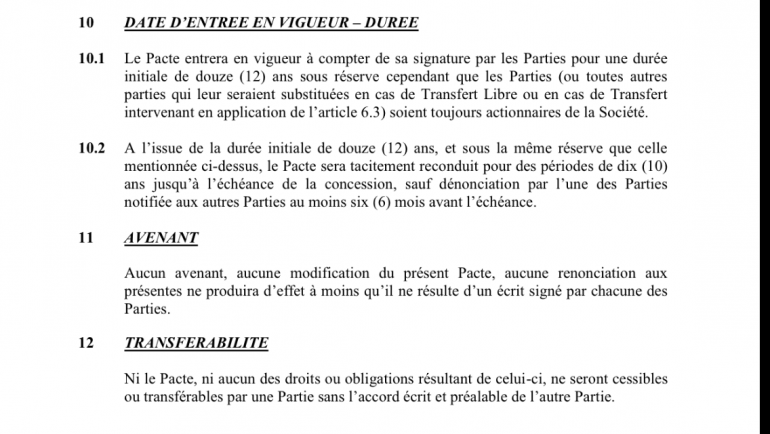Le gouvernement envisage d’accélérer la libéralisation du rail et la transformation, sinon le démantèlement, de la SNCF. Les recettes proposées sont les mêmes que celles qui ont été appliquées aux autres entreprises publiques, de France Télécom à EDF, et qui n’ont bénéficié ni aux salariés ni aux usagers. L’exemple de la libéralisation des chemins de fer britanniques, initiée dans les années 1990 et marquée par une succession de faillites et de scandales, devrait pourtant inciter à la prudence. Au Royaume-Uni, un mouvement pour la ré-appropriation de ce service public par les usagers et les salariés prend de l’ampleur.
Le 15 février, Jean-Cyril Spinetta, ancien PDG d’Air France et ancien président d’Areva, a rendu public un rapport sur l’avenir de la SNCF et du rail en France. Ce 19 février, le gouvernement vient d’ouvrir une période de concertation sur ce nouveau chantier, en recevant direction de l’entreprise publique et syndicats. Transformation de la SNCF en société anonyme, ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires, voire de la gestion du réseau, fin programmée du statut de cheminot, suppression des dessertes jugées non rentables… Les préconisations du rapport Spinetta n’ont rien pour surprendre, tant elles correspondent aux « recettes » appliquées précédemment à d’autres entreprises publiques, de France Télécom à EDF, en passant par La Poste. Elles ont immédiatement été reprises à son compte par le gouvernement, qui a annoncé l’ouverture d’une période de concertation en vue de leur mise en œuvre.
La « réforme » – ou le « démantèlement » – du service public ferroviaire serait rendue nécessaire et inéluctable par la dette de la SNCF et les exigences européennes de libéralisation du rail – l’ouverture à la concurrence étant fixée en 2020 pour les lignes nationales de transport de passagers. Ceux qui poussent ce projet – parmi lesquels il faut compter la direction de la SNCF elle-même – feraient pourtant bien de regarder ce qui se passe de l’autre côté de la Manche.
Le rail britannique est libéralisé dès les années 1990. British Rail, l’ancien service public, est alors divisé en plusieurs morceaux avant d’être vendu. Le réseau ferroviaire est séparé de la gestion des lignes, elles-mêmes réparties en plusieurs concessions régionales. Moins connu : la flotte des trains est confiée à des entreprises séparées, qui les louent au prix fort aux opérateurs des lignes, assurant à leurs actionnaires des millions de profits garantis d’année en année.
Hausse de 23 % des billets de train depuis la privatisation
C’est la privatisation du réseau ferroviaire – envisagée en filigrane pour la France par le rapport Spinetta, qui propose la transformation de SNCF Réseaux en société anonyme – qui en Grande-Bretagne a dégénéré le plus rapidement. Les problèmes de coordination et de perte d’expertise ont entraîné de nombreux incidents, qui ont culminé avec la catastrophe ferroviaire de Hatfield en 2000, laquelle a coûté la vie à quatre personnes. Le gouvernement s’est trouvé contraint de renationaliser le réseau dès 2002, et n’a jamais tenté de le privatiser à nouveau.
La gestion des lignes elles-mêmes est également marquée par des faillites et des scandales à répétition. Selon un sondage réalisé en 2017 pour la campagne We Own It (« Ça nous appartient »), qui milite pour la renationalisation ou la remunicipalisation des services publics au Royaume-Uni, 76% des Britanniques interrogés se déclarent en faveur d’un retour du système ferroviaire sous contrôle 100% public. Bien que les prix du train au Royaume-Uni soient parmi les plus chers d’Europe, ces services continuent d’être largement financés par les contribuables, tout en assurant des profits confortables à leurs opérateurs. Selon les chiffres mêmes du ministère britannique des Transports, les prix du train ont augmenté de plus de 23 % depuis la privatisation en valeur réelle (c’est à dire compte tenu de l’inflation). Les équipements ont vieilli. Et les firmes qui opèrent les lignes font l’objet des mêmes critiques sur la ponctualité des trains, les nombreuses annulations, les conflits sociaux, les wagons bondés et la qualité du service que la SNCF en France.
Des entreprises privées qui laissent tomber les lignes qu’elles gèrent
Tout récemment, Virgin Trains et le groupe de transport Stagecoach, les deux entreprises privées qui ont obtenu la gestion de l’East coast main line – partie du réseau reliant Londres à Édimbourg en longeant la côte Est – ont annoncé qu’elles abandonneraient leur concession trois ans avant la fin du contrat. Et qu’elles ne payeront pas les redevances qu’elles devaient verser à l’État. Apparemment, la concession n’était pas aussi profitable que ces entreprises l’avaient espéré. Cet abandon représente un manque-à-gagner de plus de 2 milliards de livres (2,25 milliards d’euros) pour le trésor public britannique. Ironie de l’histoire : l’East coast main line a été gérée directement par le gouvernement de 2009 à 2014 suite à la défaillance successive de deux prestataires privés. Elle a été re-privatisée en 2015. Ces événements n’ont pas empêché le ministère britannique des Transports de confier – et sans mise en concurrence – le contrat de concession d’une autre ligne ferroviaire, InterCity west coast, aux deux mêmes entreprises, Virgin et Stagecoach.
Le gouvernement britannique se trouve ainsi régulièrement contraint, du fait de la défaillance des acteurs privés, de renationaliser aux frais du contribuable des services qu’il avait privatisés. Un scénario qui n’est pas sans rappeler le sauvetage et la renationalisation des banques durant la crise financière de 2008. Faut-il transformer ces renationalisations involontaires en entreprises ou régies publiques pérennes ? Beaucoup commencent à se poser la question. Ils ont été rejoints par le Labour (parti travailliste) qui, sous l’égide de Jeremy Corbyn et de son numéro deux John McDonnell, a adopté pour les élections de juin 2017 un programme radical de renationalisation des services publics, suscitant l’opprobre des milieux d’affaires et de l’aile néolibérale du parti. Ce programme semble avoir trouvé un écho dans l’électorat, puisque le Labour est passé à deux doigts d’une victoire surprise et reste en position de l’emporter en cas d’élections anticipées.
La Grande-Bretagne, laboratoire européen de la privatisation
Des années Thatcher aux années Blair, le Royaume-Uni est le pays européen qui a mené le plus loin la privatisation et la libéralisation des services publics. Eau, rail, télécommunications, gaz et électricité, poste, transports urbains, prisons… Il n’y a guère que le service public national de la santé, le NHS, qui ait résisté jusqu’à présent. Les autorités britanniques ont aussi massivement développé les montages financiers de type « partenariat public privé » pour construire écoles, hôpitaux et autres infrastructures. La vague néolibérale a gagné l’intérieur même de l’État : un grand nombre de fonctions administratives de base – la gestion de certaines aides sociales, la collecte de la redevance télévisée, les services de probation, les demandes d’asile… – sont aujourd’hui confiées à des entreprises privées. Les marchés de sous-traitance administrative absorberaient aujourd’hui l’équivalent de 250 milliards d’euros, soit le tiers des dépenses publiques britanniques !
Cette politique a fait la fortune d’hommes d’affaires et d’entreprises qui se sont spécialisées sur ce créneau et vu leur chiffre d’affaires exploser en quelques années. Elle a aussi donné lieu à des scandales à répétition – comme la gestion des allocations handicapés par l’entreprise française Atos (lire notre article) – et à des faillites retentissantes. Mi janvier, l’entreprise de BTP Carillion, à laquelle le gouvernement britannique et les collectivités locales ont confié de nombreux chantiers d’infrastructures, a soudainement déclaré faillite, laissant les pouvoirs publics et des milliers de travailleurs sur le carreau. Avant de mettre la clé sous la porte, les actionnaires et les dirigeants de Carillion se sont copieusement servis. Le scénario pourrait se répéter avec Capita, une firme spécialisée dans les services financiers qui s’est enrichie en multipliant les contrats de sous-traitance à partir des années 1990. Elle aussi vient soudainement d’annoncer des difficultés financières.
« Remettre ces industries entre les mains de ceux qui les font fonctionner et les utilisent »
Cette succession d’événements et l’audace du Labour de Jeremy Corbyn ont changé le sens du vent. « C’est incroyable à quel point la situation et le débat public sur la privatisation et la nationalisation ont changé en seulement un an », se félicite Cat Hobbs, animatrice de la campagne We Own It. Au point que même le Financial Times, peu suspect de sympathies envers le Labour, a publié un bilan sans complaisance des privatisations au Royaume-Uni, admettant que le recours au secteur privé n’est pas toujours adapté et qu’une régulation gouvernementale plus active apparaît nécessaire pour empêcher les abus.
Du côté des travaillistes, on n’entend pas se contenter d’aménagements marginaux. « Face à l’ampleur des problèmes, nous devons aller aussi loin que le gouvernement travailliste dans les années 1940 [qui avait créé ou nationalisé les grands services publics britanniques au sortir de la Deuxième guerre mondiale],voire encore plus loin », affirmait récemment Jeremy Corbyn, lors d’un événement sur les « modèles alternatifs de propriété » organisé par son parti [1].
S’ils revendiquent l’objectif de renationaliser ces services, les leaders actuels du Labour assurent qu’ils n’entendent pas en revenir aux monopoles centralisés et bureaucratiques d’antan. Ils envisagent des services publics plus décentralisés, donnant un large rôle au secteur coopératif, et gérés de manière plus démocratique. « Nous devons remettre ces industries entre les mains de ceux qui les font fonctionner et les utilisent au quotidien, les travailleurs et les usagers. Personne ne sait mieux qu’eux comment les gérer », déclare John McDonnell, numéro deux du parti. « Nous devons être aussi radicaux que Thatcher l’a été en son temps. »
Quand les privatisations britanniques profitent aux entreprises publiques françaises
Les privatisations britanniques ont largement profité aux entreprises étrangères, en particulier françaises : Atos ou Steria pour la sous-traitance administrative, Vinci, Bouygues et Eiffage pour les partenariats public-privé, Sodexo pour les prisons, EDF pour l’énergie… Côté transports, des filiales de la RATP gèrent des lignes de tramway à Manchester et de bus à Londres. Keolis, filiale privée de la SNCF – à 70%, les 30% restant appartenant au fonds de pension public québécois, la Caisse des dépôts et placements –, est déjà présente sur plusieurs concessions au Royaume-Uni, notamment la plus importante, « Thameslink, southern and Great northern » (Nord et sud de Londres), marquée récemment par des conflits sociaux [2], et « Southeastern » (Sud-est du pays). Paradoxe : ces nouveaux marchés issus des anciens services publics sont souvent dominés par des entreprises qui sont la propriété de l’État français, et qui font chaque année traverser la Manche à de généreux dividendes tirés de la gestion des services privatisés britanniques.
Pendant que la Grande-Bretagne se lançait corps et âme dans des privatisations tous azimuts, les dirigeants français suivaient en effet une tout autre stratégie : celle de transformer les anciens monopoles publics – Air France, France Télécom, EDF-GDF, La Poste, SNCF, etc. – en entreprises commerciales sous le contrôle plus ou moins dilué de l’État, tirant profit de leur situation de rente en France et de la protection du gouvernement pour s’étendre à l’étranger… y compris en acquérant les services privatisés par d’autres pays. Cela explique sans doute pourquoi les dirigeants français ne se sont toujours opposés que très mollement aux politiques d’ouverture à la concurrence impulsées depuis Bruxelles. C’est exactement le modèle poursuivi depuis une dizaine d’années par la direction de la SNCF (lire notre enquête) et que le rapport Spinetta vient valider aujourd’hui en proposant la transformation de l’entreprise ferroviaire en société anonyme.
Olivier Petitjean
Source Bastamag 20/02/2018